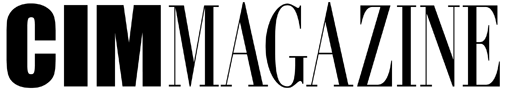Analyzing environmental DNA from the area around a mine site can be faster and more accurate than traditional biodiversity surveys.
Pour gérer les répercussions des mines sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie, les sociétés minières doivent comprendre l’impact de leurs activités sur la nature. Pour ce faire, elles doivent comprendre ce qui vit et ce qui pousse dans la zone entourant un site minier, et les répercussions sur cette zone avant, pendant et après l’exploitation d’une mine.
C’est une préoccupation d’ordre mondial. En janvier, l’International Council on Mining & Metals (ICMM, le conseil international des mines et métaux) a publié un état de la situation de la nature, dans lequel il s’engage à contribuer à un avenir positif en faveur de la préservation de la nature dans cinq domaines, à savoir : l’exploitation directe, la chaîne de valeur, les paysages entourant les exploitations, la transformation des systèmes ainsi que la gouvernance et la transparence. L’énoncé décrivait les actions spécifiques que les membres de l’ICMM peuvent prendre dans chaque domaine.
Les directives du gouvernement canadien établissent les règles régissant les actions de l’industrie minière dans le pays. Elles exigent des études de référence, évaluations des risques, la gestion et la surveillance, ainsi que des plans détaillés de l’assainissement du site après la fermeture de la mine. Si la liste des considérations est longue, l’une des choses qu’omettent ces règles est d’indiquer aux sociétés minières comment procéder.
La biodiversité constitue souvent la partie complexe d’une analyse environnementale, faisait remarquer Mehrdad Hajibabaei, professeur agrégé du département de biologie intégrative à l’université de Guelph, fondateur et conseiller scientifique en chef de la société de génomique environnementale eDNAtec basée à Terre-Neuve-et-Labrador.
« Pour la recherche de données chimiques ou physiques, il existe des capteurs [et] des systèmes automatisés. Mais lorsqu’il est question de biodiversité, les informations sont difficiles à déchiffrer, à mesurer et à comprendre », faisait-il remarquer. « Le cauchemar pour les responsables de la gestion environnementale, c’est d’être en mesure de générer des données exhaustives sur la biodiversité au bon moment. C’est la raison pour laquelle les régimes réglementaires ne sont pas aussi exhaustifs lorsqu’il est question de biodiversité. »
Dans les activités minières, il existe plusieurs domaines où les données sur la biodiversité deviennent essentielles, expliquait M. Hajibabaei. Pendant la première évaluation de référence, les sociétés minières doivent comprendre l’impact de leurs activités sur la biodiversité générale, à savoir le nombre d’espèces présentes, et si certaines sont menacées d’extinction ou soumises à de fortes pressions, et doivent donc être protégées. Ces activités ne concernent pas uniquement la mine en elle-même. Elles doivent aussi tenir compte d’aspects tels que la construction de routes vers le site, l’exploitation de lignes électriques ou d’autres activités qui modifient l’état de l’environnement.
Ensuite, lorsque la mine est déclassée, les activités de remise en état doivent garantir que le site retrouve son état naturel initial. « Plutôt que de [se contenter] de s’asseoir sur l’herbe pour voir si elle est bien verte, nous voulons nous assurer de la diversité des organismes qui la peuplaient auparavant », indiquait M. Hajibabaei.
Changement d’échelle
Dans les évaluations manuelles, des travailleurs de terrain effectuent une vérification en personne de l’environnement afin de consigner la faune et la flore. Ces évaluations sont, certes, utiles, mais elles sont inefficaces. De fait, elles exigent une grande main-d’œuvre, sont chronophages, onéreuses et requièrent la présence d’experts en écologie sur de longues périodes.
« Par ailleurs, la faible disponibilité d’experts en taxonomie pouvant effectuer ces travaux (étant donné que la demande dépasse l’offre) limite la collecte de données à la vitesse et à l’échelle nécessaires au sein de l’industrie minière », expliquait Rachel Mador-House, qui a travaillé pour des sociétés minières telles qu’Anglo American, Teck Resources, Rio Tinto et Glencore et qui est désormais responsable des affaires scientifiques pour l’Amérique du Nord à NatureMetrics, une société spécialisée dans la technologie de l’intelligence de la nature.
Grâce à une approche relativement nouvelle, une évaluation environnementale peut être menée plus rapidement et plus précisément en analysant l’ADN environnemental (ADNe).
« Les études de l’ADN nous permettent de détecter des espèces sans les voir ni les entendre, mais en recueillant des quantités infimes d’ADN, ou “ ADNe ”, que les organismes laissent dans l’environnement », expliquait Joshua Newton, doctorant au Trace and Environmental DNA Laboratory (TrEnD, le laboratoire de l’ADN environnemental et des traces d’ADN) à l’université Curtin en Australie. « Nous sommes désormais en mesure d’exploiter cet ADN en collectant un échantillon non invasif dans l’eau, sur des plantes ou en tamponnant une matière végétale. On retire ensuite l’ADN de l’échantillon, on amplifie et on analyse cet ADN, puis on le cartographie de nouveau dans une base de données de référence, qui nous donnera une liste d’espèces dont l’ADN est présent dans cet échantillon. »
L’ADN peut provenir de diverses sources, notamment les organismes eux-mêmes, des cellules dispersées, du matériel de reproduction tels que des graines ou des spores d’organismes plus gros, ou même des matières fécales. On peut aussi récupérer l’ADN dans des endroits tels que des pièges à insectes, des échantillons trouvés dans des cours d’eau ou dans l’eau directement. M. Newton travaille aussi sur de nouvelles méthodes pour récupérer des échantillons, tels que la collecte d’ADN des pollinisateurs dans des fleurs, et il cherche à déterminer la capacité des toiles d’araignées à capturer l’ADN des vertébrés.
Par rapport aux méthodes d’observation traditionnelles, indiquait Mme Mador-House, l’échantillonnage d’ADNe est une pratique hautement évolutive. Elle permet de suivre plusieurs espèces simultanément, et peut servir à contrôler de vastes zones et des environnements variés qui offriront des ensembles de données plus larges et plus précis. « Essentiellement, elle est bien plus simple à utiliser sur le terrain, exige moins de soutien de spécialistes sur place. Elle est donc plus rapide et moins coûteuse à utiliser », expliquait-elle. « Elle est conçue pour être facilement reproductible. En outre, parce que les données sont normalisées, cette méthode offre une image extrêmement précise de l’évolution d’un écosystème au fil du temps, ce qui permet aux sociétés de prendre des décisions plus éclairées et qui auront plus d’impact pour la nature. »
Adam Cross, spécialiste principal en biodiversité à la société minière australienne Mineral Resources (MinRes), qui a déjà collaboré avec l’université Curtin sur la recherche dans le domaine de l’ADNe, indiquait que les études de l’ADNe « requièrent souvent moins d’expertise en matière de taxonomie que les études traditionnelles de la faune et la flore pour fournir quelque chose de comparable à une empreinte génétique indiquant quelles espèces de différents groupes d’organismes sont présentes dans une région ».
Il ajoutait que les études de l’ADNe sont susceptibles de représenter un complément puissant aux techniques traditionnelles de surveillance de la biodiversité. « Elles peuvent constituer une méthode moins onéreuse et plus rapide de capturer une image holistique de la biodiversité dans une région. Elles permettent aussi de détecter de manière plus fiable des organismes qui pourraient être difficiles à identifier ou à distinguer d’autres organismes similaires, par exemple des sous-espèces ou des plantes que l’on ne peut différencier l’une de l’autre que lorsqu’elles sont en fleur », expliquait-il. « Les études de l’ADNe permettent aussi de détecter des organismes qui ne sont généralement pas pris en compte dans les études traditionnelles, telles que les champignons, les mousses et les microbiotes [micro-organismes]. »
Comme l’indique Matt Brekke, premier biologiste à Stantec, les études de l’ADNe permettent aussi de découvrir de petites espèces difficiles à détecter. « Étant donné que certaines espèces sont en danger, il est très important d’être précis dans les études d’absence/de présence », faisait-il remarquer.
Il n’est pas toujours nécessaire de mener ces études individuellement. Il existe des manières de recueillir des échantillons en toute efficacité et à bas coût pendant d’autres activités de surveillance, expliquait Joe Huddart, ingénieur en solutions sur la biodiversité et expert du secteur minier à NatureMetrics. « L’eau constitue souvent la porte d’entrée pour la surveillance de l’ADNe dans un site minier. Les essais routiniers sur l’eau pour détecter une pollution ou une contamination sont l’occasion idéale de recueillir des échantillons d’ADNe », indiquait-il. « En recueillant l’ADNe ainsi que des données physico-chimiques, les mines peuvent ajouter une couche de données exhaustives sur la biodiversité avec un effort logistique supplémentaire très limité ».
En outre, indiquait M. Huddart, le prélèvement d’échantillons du sol est utile pour identifier une contamination du sol et suivre la réussite de la revégétation. « Au final, c’est le microbiome du sol qui dicte quelles plantes poussent au-dessus du sol. Ainsi, en caractérisant les organismes du sol, il est possible d’identifier quelles espèces sont présentes ou absentes », expliquait-il.
Les limites
Toutefois, l’étude de l’ADNe ne remplacera pas entièrement les études environnementales traditionnelles. Elle présente deux limites. D’une part, elle ne permet de détecter que la présence (ou l’absence) d’un organisme, et pas nécessairement sa quantité. D’autre part, elle ne peut identifier que les espèces dont l’ADN existe déjà dans une base de données de référence.
« Lorsqu’il est question de quantification, nous ne pouvons pas compter sur des organismes individuels car nous ne les capturons pas. Mais nous pouvons fournir d’autres mesures pour y remédier », indiquait M. Hajibabaei. « Nous pouvons utiliser des données de prévalence pour obtenir des mesures quantitatives. Par exemple, si l’on recueille 10 échantillons et que l’on trouve l’ADN d’une certaine espèce dans cinq d’entre eux, ceci montre que dans cette région, la prévalence de cette espèce est de 50 % relativement. [Dans] un autre site, cette prévalence pourrait atteindre 80 %. Ainsi, on peut donner des mesures quantitatives, mais on ne peut pas recenser les poissons ou les oiseaux. »
Il faisait remarquer qu’il n’existe pas de bibliothèques de référence sur l’ADN pour chaque espèce. « Pour pouvoir mettre un nom sur un échantillon d’ADN que nous recueillons dans l’environnement, nous devons le comparer à l’ADN de référence », indiquait-il. « Dans certains groupes taxonomiques, du moins dans certains contextes, tels que les grands mammifères, nous avons des références. Mais dans un contexte marin ou dans un site isolé par exemple, on observe un amphibien ou un poisson et on les compare à l’ADN, sans pouvoir nécessairement mettre un nom sur toutes les espèces. »
C’est la raison pour laquelle les organisations qui mènent des tests ADNe appellent au développement de bibliothèques de référence sur l’ADN plus exhaustives.
L’International eDNA Standardization Task Force (iESTF, le groupe de travail international sur la normalisation de l’ADNe) a été créé par M. Hajibabaei en 2023 pour faire face à ce genre de difficultés. Ses adhérents à l’échelle mondiale s’efforcent de développer des normes internationales sur l’ADNe et encouragent leur adoption. Ils aident aussi à établir des exigences de qualité pour les procédures normalisées tout en « laissant une certaine latitude pour la croissance et l’optimisation dans ce domaine qui évolue rapidement », peut-on lire sur le site Internet. L’iESTF collabore également avec des groupes de travail ISO pour le développement concret de normes relatives aux applications, engage le dialogue avec plusieurs parties prenantes et tient lieu « d’entité à contacter pour obtenir des renseignements, des ressources et du matériel éducatif ».
Compte tenu des limites actuelles, Mme Mador-House expliquait que, s’il n’est pas prévu que les tests ADNe remplacent les études traditionnelles sur la biodiversité dans un proche avenir, ils restent toutefois un complément précieux. « Nous aurons toujours besoin d’une surveillance traditionnelle des espèces à l’aide de transects et d’individus hautement qualifiés sur le terrain », indiquait-elle. « Toutefois, le nombre de spécialistes en écologie et en taxonomie n’est pas suffisant pour répondre à la demande, et nous nous trouvons face à un goulet d’étranglement. L’ADNe peut contribuer à pallier ce problème, tout en complétant et en soutenant les équipes de terrain. »
M. Huddart indiquait un autre avantage du test ADNe. « La simplification des complexités de la nature en des mesures chiffrées compréhensibles signifie que l’on peut transposer les données d’un site dans une salle de réunion et les présenter aux personnes intermédiaires, en indiquant de manière transparente l’impact et les progrès réalisés en faveur des engagements organisationnels envers la nature. »