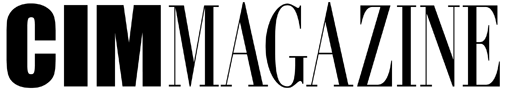« Mike Forcia, activiste de l’American Indian Movement (AIM, le mouvement indien américain), s’est entretenu avec un agent de police d’État envoyé sur les lieux pour encourager les manifestants à suivre une procédure légale avant de retirer la statue qui trônait au Capitole depuis 1931. M. Forcia lui a répondu qu’ils avaient tenté cette voie-là à plusieurs reprises, mais sans succès.» – Minneapolis Star Tribune, 11 juin 2020
C’est ainsi que les manifestants ont encordé la statue de Christophe Colomb, l’ont hissée de son piédestal et l’ont jetée à terre.
En mars, lorsque nous avons pris un virage difficile et sommes entrés en auto-isolement pour ralentir la propagation du coronavirus, nous savions qu’il y aurait des conséquences. Les débats s’articulaient autour de la perturbation de nos vies professionnelles et personnelles, de la menace du virus et de la charge imposée au système de santé par les mesures, ainsi que des répercussions à court et à long termes sur l’économie mondiale. S’il était difficile de prévoir l’issue finale, on pouvait tout au moins envisager à quoi elle ressemblerait.
Les semaines d’isolation, l’agitation et l’anxiété constituent un mélange détonant. C’est dans ce contexte que les images de la mort lente et brutale de George Floyd sous le genou d’un officier de police ont été rendues publiques. Les frustrations qui s’accumulaient depuis des générations, la colère face à la liste trop longue de noms d’autres personnes ayant péri dans des circonstances similaires, le lourd tribut de la COVID-19 sur les communautés afro-américaines et l’aliénation sévère résultant de semaines de confinement venaient de trouver un exutoire. C’est ce moment précis qui a déclenché l’expression de griefs de longue date, si fortement ancrés dans l’histoire et qui s’étendent bien au-delà de la brutalité policière. Cette manifestation d’une colère refoulée est arrivée avec une telle force que les personnes qui étaient jusqu’ici parvenues à faire taire cette agitation pour obtenir des changements ont finalement dû y faire face et, plus important encore, l’écouter.
Si ces revendications se concentrent principalement aux États-Unis, les histoires qu’ont partagées nombre de Canadiens, y compris des collègues de l’ICM d’hier et d’aujourd’hui, montrent bien que ce problème ne concerne pas que nos voisins américains. Nous avons, nous aussi, un passé jalonné d’injustices persistantes que nous ignorons collectivement.
Si toutefois nous décidons de lui accorder notre attention, nous éviterons d’être déconcertés face à l’inévitable question du « que faire ? ». Nous avons au moins quelques orientations ; il y a un an, le « rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées » était publié. Ce rapport donnait une description détaillée du racisme systémique au Canada et présentait un certain nombre de mesures correctrices.
Si la plupart des mesures présentées dans ce rapport s’adressaient aux gouvernements, les recommandations concernaient également la presse et les industries de l’extraction. Pour des organes de presse tels que le CIM Magazine, le rapport appelait à intégrer les populations autochtones dans la couverture médiatique et la production de contenu ; pour les industries de l’extraction, il leur demandait d’expliquer la raison pour laquelle les répercussions et les avantages du développement n’étaient pas distribués équitablement aux communautés autochtones.
Il est grand temps de commencer à agir.Traduit par Karen Rolland