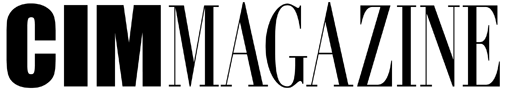En juin, j’achetais une copie de l’ouvrage Comment marche vraiment le monde - Le guide scientifique du passé, du présent et du futur de Vaclav Smil (traduit de l’anglais par Jacques Treiner). La description sur la jaquette est presque trompeuse par rapport au contenu de cet ouvrage. Elle le qualifie « d’analyse essentielle de la science et la technologie modernes qui façonnent nos vies au XXIe siècle ». Ce qui, certes, est judicieux, car il serait moins vendeur de le décrire de la manière suivante : « Pourquoi nous devons faire preuve de plus de circonspection quant à notre dépendance vis-à-vis du pétrole brut, du béton, de l’acier et des engrais ».
Accompagné de l’ouvrage de M. Smil qui me trottait dans la tête, je partais en Espagne pendant que le reste de l’équipe éditoriale s’attelait à la tâche et préparait ce numéro (si vous avez la chance d’atteindre 50 ans, pourquoi ne pas les fêter dignement ? Après tout, cela n’arrivera qu’une fois). C’est la raison pour laquelle, lors de l’une de mes premières étapes au musée Guggenheim de Bilbao, j’avais l’esprit occupé par la réalité matérielle des choses, et non pas simplement par la mortalité.
La plupart des gens reconnaîtront ce musée d’art contemporain visuellement à ses murs ondulant massifs composés de fines plaques de titane (un minerai extrait en Russie, traité et profilé aux États-Unis). Une installation audiovisuelle panoramique récente occupait une grande pièce à l’intérieur. Ce spectacle, créé par intelligence artificielle (IA), présentait une exposition fluide réunissant créations, textures et couleurs générées à l’aide d’une base de données d’images ajoutées à un « vaste modèle architectural ». Une séquence audio générée par IA complétait la projection lumineuse panoramique.
« S’appuyant sur des données respectueuses des principes éthiques et alimentées par des pratiques informatiques durables », indiquait la commissaire de l’exposition, « cette installation reflète une approche consciencieuse de la création numérique, où l’innovation et la responsabilité vont de pair ». À tout point de vue, cette installation était la définition même du contemporain. C’est aussi celle qui attirait le plus de monde.
L’inquiétude de M. Smil est que, dans notre économie postindustrielle axée sur les services, nous avons perdu de vue le fait que, si les logiciels sont une source de divertissement inépuisable, ce sont les combustibles fossiles et la production de matériaux à haute teneur en carbone qui aident les milliards d’humains à répondre à leurs besoins fondamentaux. En faisant abstraction de cette réalité, on renforce l’idée selon laquelle la neutralité en matière d’émissions de gaz à effet de serre dans les 25 années à venir sera possible sans effets profondément perturbateurs. Dans le même temps, il devient toujours plus difficile d’avoir des conversations fructueuses sur les moyens les plus efficaces de réduire notre bilan carbone massif.
Ainsi, l’œuvre qui s’est montrée à la hauteur des circonstances est une série d’installations permanentes de sculptures composées de magnifiques feuilles d’acier érodées. Sachant que Bilbao était un centre important de construction navale, la nature du matériau était tout aussi indispensable à l’expérience que les créations fluides en métal que l’artiste a créées.
Si la structure de l’exposition sur l’IA insistait sur l’absence d’empreinte physique, le résumé accompagnant les sculptures en acier racontait en détail la relation de plusieurs millénaires de la région avec ses gisements de fer. Présentée dans la collection permanente du Guggenheim qui existe grâce aux richesses amassées par l’exploitation minière et le traitement des métaux, cette installation affichait une conscience de ses origines que nous serions bien inspirés de prendre au sérieux.
Traduit par Karen Rolland