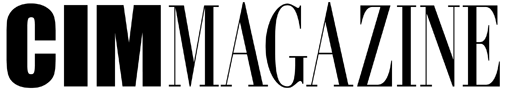Ils pourraient (et devraient) être des occasions d’améliorer les délais entre l’exploration et la mise en service, permettant à l’industrie minière de procéder à un examen interne. Le récit relatif aux formalités administratives masque aisément une réalité pesante. De fait, nombre de nos méthodes de conception restent ancrées dans une ère où les considérations environnementales arrivaient au second plan, et où les exigences sociétales étaient terriblement différentes de celles d’aujourd’hui.
Réimaginer l’éducation minière
Pour faire face à ce problème, les universités, les entités professionnelles et les autorités réglementaires doivent unir leurs efforts. Par exemple, les programmes universitaires n’auront guère d’utilité à introduire des notions de conceptions innovantes si les pratiques industrielles et les cadres réglementaires d’attribution de permis continuent leur fixation sur l’utilisation de méthodes empiriques qui ont été développées dans les années 1960 et 1970, telles que le système de classification des masses rocheuses. Inversement, la pratique modernisée et les lignes directrices relatives aux permis requièrent des programmes universitaires pour adopter un contenu innovant et plus rationnel. Chaque mine constitue un système interdisciplinaire complexe. L’industrie minière doit accorder une plus grande attention à l’identification de la relation de cause à effet qui gouverne chaque mine de manière indépendante, plutôt que de s’en remettre à des convictions établies et de les mettre en pratique dans les nouveaux projets.
Des pratiques d’ingénierie à moderniser
Les exploitations minières contemporaines exigent plus que de simples compétences techniques. Elles demandent d’adopter une approche holistique intégrant des technologies de pointe, une bonne intendance de l’environnement et un engagement auprès de la communauté. Pourtant, nos pratiques professionnelles résistent souvent à une transformation significative.
Prenons par exemple le génie géotechnique, où l’on utilise des modèles numériques sophistiqués tout en se reposant sur des méthodes des intrants qui restent largement empiriques et qualitatives. Notre domaine est façonné par des biais cognitifs qui rejettent souvent des valeurs aberrantes plutôt que de se demander si nos convictions établies s’appliquent totalement à des cas de figure spécifiques. Ceci crée un cycle vicieux où l’attachement préférentiel aux méthodes traditionnelles constitue une entrave à l’innovation et à l’adaptation.
Lorsque se posent des questions de réglementation, cette adhérence rigide à des approches conventionnelles ralentit non seulement le processus, mais peut aussi totalement mettre en pause le progrès. Les retards d’attribution de permis n’émanent pas d’obstacles bureaucratiques, mais de notre réticence à envisager sous un autre angle des pratiques établies. Nous devrions considérer les enquêtes réglementaires non pas comme des obstacles, mais plutôt comme des occasions d’améliorer la communication et de perfectionner nos approches.
Pour aborder le problème des retards associés aux processus de réglementation dans les projets miniers, il est essentiel de mettre en œuvre un cadre d’évaluation technique collaboratif qui implique les détendeurs de droit tels que les communautés autochtones, dès le départ. Les projets miniers doivent commencer par une collaboration dès les premières étapes, qui inclut les expertes et experts techniques des sociétés minières, et celles et ceux désignés par les détendeurs de droit. L’objectif est de capter différentes perspectives avant que les plans de conception ne soient finalisés et difficiles à modifier. Cette collaboration doit continuer durant l’intégralité du cycle de vie de la mine, y compris la fermeture et la remise en état. La collaboration dès les premières étapes nous donne la possibilité de réduire, voire d’éliminer de longues actions en justice. Adopter des positions extrêmes de chaque côté du spectre (pour ou contre l’exploitation minière) a une incidence sur le dialogue constructif entre des points de vue divergents. Cela élimine la possibilité d’un compromis et de stratégies pratiques de mise en œuvre, qui pourraient sinon être rejetées par celles et ceux tenant des positions plus rigides.
D’un point de vue technique, je suggère aux sociétés d’utiliser la modélisation avancée et l’analyse des cas de figure pour montrer que les performances d’autres conceptions peuvent s’avérer supérieures sur le plan environnemental durant le cycle de vie de la mine. De la même manière, elles pourraient développer des évaluations des risques comparatifs qui quantifient les avantages de nouvelles approches par rapport aux méthodes traditionnelles.
La technologie disponible aujourd’hui (imagerie géospatiale avancée, apprentissage automatique et modélisation numérique de pointe) offre des possibilités sans précédent pour minimiser les impacts sur l’environnement tout en renforçant l’efficacité opérationnelle. Ces outils nous permettent de simuler les résultats à long terme, d’anticiper les changements environnementaux et de concevoir des exploitations dotées d’une intégrité sur des décennies. Toutefois, leur mise en œuvre efficace requiert plus que l’adoption de nouveau matériel. Cela demande une transformation de la philosophie centrale du génie minier.
La plupart des méthodes de conception en mécanique des roches ont été développées lorsque la priorité n’était pas de réduire l’empreinte d’une mine. Les approches géotechniques traditionnelles abordent la question de la fermeture de la mine comme la phase finale, plutôt qu’une considération intégrale de la conception de la stabilité. Cette perspective ne tient pas compte du fait que l’exploitation minière représente une utilisation des sols temporaire qui doit, à terme, être rendue à son propriétaire légitime. En intégrant la planification de la remise en état dès la phase d’exploration, nous pourrions donner la priorité aux méthodes d’extraction qui minimisent les déchets et protègent les ressources en eau et les écosystèmes.
La transparence comme avantage concurrentiel
L’innovation critique ne peut se développer dans un environnement manquant de transparence. De la même manière, les approches qui mettent en balance l’extraction des ressources et les responsabilités sociales et environnementales sont vouées à l’échec si notre industrie n’adopte pas le partage de l’information. Lorsque nous citons des rapports confidentiels ou inaccessibles dans les documents d’attribution de permis, nous demandons aux organismes de réglementation et aux communautés de nous faire confiance et non de vérifier nos revendications. Cette position de confiance non vérifiée prolonge inévitablement l’examen minutieux.
La confiance se développe au travers de la transparence et de la reproductibilité, et non au travers d’affirmations fondées sur des preuves dissimulées. La pratique consistant à fonder les normes techniques sur des revendications sans examen minutieux précis crée des bases précaires pour les projets miniers. Notre industrie doit accepter que les accords de confidentialité ne s’étendent pas aux documents techniques essentiels aux applications minières et aux intérêts des détenteurs de droit.
En effet, le principe de consentement éclairé exige une transparence complète concernant chaque élément d’une proposition de projet ou d’activité. Les informations doivent y être présentées de manière accessible à celles et ceux dont le consentement est requis. Les cadres réglementaires d’attribution de permis doivent être corrigés pour exiger des sociétés minières qu’elles partagent toutes les informations techniques pertinentes au moment de l’envoi d’une demande d’attribution de permis, et non pas uniquement sur demande pendant l’étape d’évaluation. Ceci ne doit pas être perçu comme une charge supplémentaire, mais plutôt comme une occasion d’éviter de longs processus d’examen. De fait, les examinateurs et examinatrices techniques peuvent trouver des réponses à leurs questions dans des documents qui, dans le cadre actuel d’attribution de permis, pourraient être classés comme des rapports confidentiels.
La voie à suivre
Le chemin le plus direct vers l’approbation d’une mine ne passe pas par des raccourcis réglementaires, mais par une transformation de l’industrie, qui présente des avantages clairs pour la société. En adoptant des approches de conception holistique, en embrassant la transparence et en modernisant nos pratiques d’ingénierie, nous renforcerons la confiance et l’efficacité nécessaires pour accélérer le processus d’attribution de permis. L’industrie minière se trouve à un carrefour. Nous pouvons continuer à attribuer les retards à des facteurs externes, ou être les instigateurs et instigatrices d’une transformation qui abordera les préoccupations légitimes à l’origine des processus réglementaires. Le choix est clair : l’innovation offre une voie vers des approbations plus rapides, mais aussi vers un secteur minier plus durable et respecté pour les générations à venir.
Davide Elmo est professeur d'ingénierie des roches à l'Institut Norman B. Keevil d'ingénierie minière de l'Université de Colombie-Britannique.
Traduit par Karen Rolland