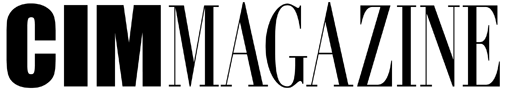En approfondissant mes recherches sur les gros titres actuels consacrés aux efforts ambitieux visant à accélérer la réalisation de grands projets au Canada, je me suis retrouvé 45 ans en arrière, à un moment clé de l’histoire de ce pays qui présente un parallèle avec la situation actuelle : le Constitution Express.
Les dirigeants autochtones de la Colombie-Britannique, profondément préoccupés par le fait que les droits de leur peuple seraient ignorés par le rapatriement de la Constitution canadienne au début des années 1980, ont affrété deux trains qui les ont emmenés, ainsi que les partisans qui les ont rejoints en cours de route, à Ottawa pour défendre leurs intérêts. Lorsque le gouvernement dirigé par Pierre Trudeau n’a pas répondu de manière adéquate à leurs préoccupations, les chefs de file se sont rendus à New York, au siège des Nations Unies, puis ont fait plusieurs étapes en Europe, pour finir à Londres, où la Constitution canadienne était encore soumise au droit britannique.
Il en résulta l’ajout d’une section à la Constitution qui reconnaissait les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones, ce qui ne figurait pas dans le projet qui avait donné le coup d’envoi au départ du Constitution Express vers l’Est.
Des décennies plus tard, bien que ces droits soient protégés, nous avons encore du mal à mettre en place des projets qui les intègrent dans le cadre constitutionnel.
Les gouvernements adoptent des lois au nom de l’accélération des projets – dont beaucoup visent à exploiter les ressources naturelles—dans l’intérêt national, tandis que, comme le détaille Kelsey Rolfe (uniquement en anglais), les dirigeants autochtones du Canada s’opposent à ces lois, estimant qu’elles pourraient contourner l’obligation de consultation et bafouer le principe du consentement.
Si les gouvernements fédéral et provinciaux ne parviennent pas à apaiser ces inquiétudes, ces nouvelles lois et la résistance potentielle qu’elles suscitent pourraient tout aussi bien nous faire reculer dans le temps plutôt que de jeter les bases d’un avenir nouveau et audacieux.
Combien de temps en arrière ? Dix-sept ans, peut-être.
Le projet cuprifère et aurifère Prosperity, situé dans le centre de la Colombie-Britannique, proposé pour la première fois en 2008, s’est heurté à une opposition constante de la Première Nation locale, malgré son approbation par le gouvernement provincial. Ashley Fish-Robertson a compilé une chronologie utile des événements clés de ce long conflit (uniquement en anglais). En juin, un accord a finalement été conclu, ouvrant la voie à la reprise du projet. L’un des éléments centraux de cet accord est l’obligation pour la Nation Tŝilhqot’in de donner son consentement avant que tout développement puisse avoir lieu.
L’autre élément clé de l’accord est la participation aux droits miniers, que la province a accepté d’acheter à leur détenteur actuel, Taseko Mines, et de transférer à la Nation Tŝilhqot’in.
Il existe un nombre croissant d’études de cas et d’exemples de réconciliation économique. L’équité autochtone dans les projets liés aux ressources naturelles continue de gagner du terrain. De même, les coentreprises avec des entreprises autochtones dans le cadre du développement de ces projets, tels que ceux de la mine Raglan mis en avant par Cedric Gallant, constituent également des modèles pour l’avenir.
Et pourtant, nous semblons nous diriger dans une direction différente où, à moins que des efforts très ciblés et de bonne foi ne soient déployés tant au niveau provincial que fédéral pour consulter les Autochtones et les faire participer, les projets accélérés dans l’intérêt national se heurteront presque certainement au Constitution Express.
Traduit par Julien Richard