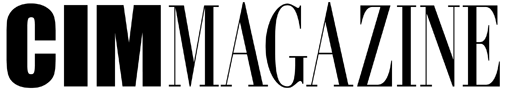Andy Low est spécialiste principal des feux de végétation et professionnel agréé à Forsite Fire, un département de Forsite Consultants. Fort de 25 années d’expérience dans la gestion des incendies de forêt, M. Low a commencé sa carrière en tant que pompier luttant contre les feux de végétation. Il a travaillé dans certaines des régions du Canada parmi les plus vulnérables aux feux de forêt. Son expérience inclut la lutte contre l’incendie en rappel (descente en rappel d’un hélicoptère dans des zones autrement inaccessibles pour lutter contre les incendies) avec Parcs Canada et le programme Rattapack du British Columbia Wildfire Service (BCWS, le service de lutte contre les incendies de Colombie-Britannique), suivie de plusieurs années dans la zone d’incendie active de Penticton, dans la région d’Okanagan.
M. Low a ensuite occupé un poste d’agent provincial de préparation contre les incendies de forêt au Provincial Wildfire Coordination Centre (le centre de coordination provincial des feux de forêt) à Kamloops, avant de rejoindre John Davies à Davies Wildfire Inc. en 2017. MM. Davies et Low ont alors lancé une nouvelle société de conseil, Frontline Operations Group, en 2019. Ils ont vendu la société à Forsite Consultants en 2023, et sont désormais à la tête de l’équipe de Forsite Fire, qui se concentre sur les risques, les impacts et les stratégies d’atténuation des incendies adaptés à chaque communauté, gouvernement et client de l’industrie, dont les exploitants miniers.
Dans une conversation avec l’équipe du CIM Magazine, M. Low nous fait part de sa vision de l’évolution des risques de feux de forêt, de ce que doivent faire les exploitations minières pour comprendre les questions d’atténuation et de résilience, et du rôle des technologies émergentes pour améliorer la planification et la préparation dans des situations d’urgence.
L’ICM : Quels risques importants les incendies constituent-ils pour une exploitation minière, et quelles sont leurs incidences majeures ?
M. Low : Lorsqu’il est question de feux de forêt, nous devons faire la différence entre le stade auquel se trouve une mine et son empreinte. Par exemple, une mine établie en exploitation est, en règle générale, résiliente face aux impacts directs des feux de forêt, car de grandes zones défrichées entourent généralement le site, et les matériaux autour du site sont souvent ininflammables, par exemple des roches, des graviers et l’espace défendable. Par espace défendable, on entend un espace entre une structure et des combustibles de végétation à proximité [des matières combustibles qui peuvent nourrir un feu, par exemple, la végétation ou toute autre matière organique]. Un espace défendable adéquat permet de ralentir ou de stopper la progression d’un incendie de forêt. [Il] offre aussi aux pompiers luttant contre les feux de végétation suffisamment d’espace autour des structures pendant les opérations de lutte contre les incendies et de protection des structures. Les bâtiments sont aussi habituellement construits avec des matériaux non combustibles tels que du métal ou du béton.
Ce sont toutes les autres choses qui pourraient se trouver dans l’empreinte de la mine qui préoccupent, à savoir les véhicules, les matériaux [ou] les débris accumulés ou non encore éliminés. Pendant un incendie de forte intensité, ce n’est pas juste une chaleur radiante, mais aussi des braises qui sont projetées loin devant un feu de cime actif. Avec un espace défendable adéquat, ce ne sont souvent pas les hautes flammes qui brûlent les bâtiments, mais les braises qui mettent le feu à certaines parties d’un bâtiment, à des matériaux ou à des combustibles à proximité. Ce feu se propagera ensuite à l’intégralité de la structure et potentiellement d’un bâtiment à l’autre.
Notre plus grande préoccupation est toutefois l’impact du feu sur les différentes infrastructures essentielles de la mine, qu’il s’agisse des routes pour le transport ou des lignes de transport et de distribution de l’électricité qui traversent de longues distances au travers de zones boisées. La menace de l’incendie ne se limite pas au site minier, mais concerne toutes ces connexions diverses dont dépend la mine.
Quelle que soit la taille ou l’ampleur d’une exploitation (qu’elle se trouve au stade de l’exploration minérale ou de la pleine production), nous devons nous rappeler que nous évoluons dans un environnement très vulnérable aux feux de forêt et nous y sommes exposés. Les exploitants doivent comprendre et prévoir les risques de feux de forêt pour leur personnel et leurs actifs.
L’ICM : À quoi ressemble une stratégie efficace d’atténuation des risques pour les exploitations minières ?
M. Low : Nous la concevons comme un parcours vers la résilience vis-à-vis des feux de forêt, et cela commence par la quantification ou la caractérisation des risques. Lorsque nous menons une évaluation des risques, nous cherchons différents facteurs de l’environnement des feux de forêt dans lequel sont situées la mine et ses dépendances, notamment les types de combustibles, de végétation et de forêts.
Nous étudions aussi la topographie. La mine se trouve-t-elle sur un terrain plat, en haut d’une colline ou à son pied ? Qu’en est-il des lignes électriques ou des routes, sont-elles situées en terrain surélevé ou en fond de vallée ?
Nous examinons ensuite les conditions météorologiques dominantes et historiques, et les analysons à l’aide de la méthode canadienne d’évaluation des dangers d’incendie de forêt (MCEDIF). Nous analysons les codes relatifs à l’humidité des combustibles [évaluation numérique de la teneur en humidité de la couche holorganique, ou parterre forestier, et d’autres matières organiques mortes] ainsi que les indices de comportement des feux au fil du temps. Nous recherchons ensuite des tendances grandissantes, car ce sont de bons indicateurs d’une augmentation des risques.
Dans le cadre d’un programme complet d’évaluation et d’atténuation des risques de feux de forêt, la présence sur le terrain est indispensable. Une évaluation à distance reste limitée. Notre présence ou celle d’un conseiller ou d’une conseillère spécialiste des feux de forêt sur le site minier est extrêmement précieuse. Cela nous permet de mieux comprendre les principaux actifs et processus en jeu. Lorsqu’on peut se rendre sur le site et évaluer la structure des combustibles et la relation entre l’environnement bâti et l’environnement boisé, cela permet de réunir des informations concernant les risques possibles au cas où la mine serait menacée par un feu de forêt.
Nous associons donc analyse à distance et évaluation sur place. L’intégration de ces facteurs à l’activité du site nous confère un sens aigu des risques généraux pour le site et l’exploitation.
À partir de là, il s’agit de trouver des manières d’atténuer ces risques. Dans certains cas, ces atténuations peuvent être très simples. Elles peuvent porter sur le nettoyage d’un site, l’élimination de bâtiments en bois délabrés très vulnérables aux départs de feux par les braises. Il peut s’agir de retirer des matériaux inflammables des structures permanentes, ou encore d’évaluer l’intégralité du réseau routier qui relie tout à la mine ou l’électricité acheminée jusqu’à elle. Nous envisageons aussi des stratégies telles que la création ou l’augmentation de l’espace défendable en défrichant, ainsi que des possibilités d’intégrer des solutions de protection telles que des enveloppes protectrices pour les poteaux électriques en bois. Ce sont des exemples d’atténuations physiques possibles.
Pour faire le lien entre tous ces éléments, nous aidons nos clients à déterminer comment incorporer au mieux les risques de feux de forêt dans leurs plans d’intervention en cas d’urgence. Repèrent-ils le danger d’incendie ? Sont-ils conscients du comportement possible du feu qu’ils pourraient rencontrer aujourd’hui, demain ou dans une semaine ? L’exploitation dispose ainsi des meilleures informations pour envisager la planification quotidienne et, si nécessaire, pour commencer à mettre en œuvre une intervention en cas d’urgence et prendre des décisions informées quant à la sécurité du personnel et à la protection des actifs sur le site.
L’ICM : Pouvez-vous nous donner un exemple réel d’une stratégie d’atténuation mise en œuvre par Forsite Fire, et la valeur globale qu’elle a conférée aux clients ?
M. Low : Prenons en exemple un projet que nous avons mené dans le Yukon en 2024, qui reflète bien la valeur d’une évaluation sur place avec nos propres yeux et l’importance de nous entretenir directement avec les personnes responsables des activités essentielles. Cette mine était en mode de soins et maintenance, en phase de passer à l’étape de l’assainissement. Le site présentait des problèmes de qualité de l’eau et était équipé d’un réseau de systèmes d’extrémité de ligne qui isole, détourne et capte l’eau contaminée puis l’aspire par pompe vers une usine de traitement de l’eau ou la renvoie dans un étang de retenue.
Le site est immense. La plupart des bâtiments sont situés dans un vaste paysage de roches concassées et de routes. Toutefois, les systèmes d’extrémité de ligne de captage et de pompage sont situés à l’extrémité de la mine et à proximité de la forêt. Durant le processus d’évaluation, nous avons pu nous concentrer sur la fonction la plus importante du programme de soins et maintenance, à savoir éviter que l’eau contaminée ne pénètre l’environnement.
Si les feux venaient à toucher ces sites extrêmement importants, cela pourrait entraîner une pénétration de l’eau contaminée dans l’environnement et provoquer toute sorte de problèmes. Je ne sais pas si une analyse à distance aurait pu communiquer adéquatement ce genre d’informations ni le degré d’importance que représentent ces sites. Tout ceci s’est fait grâce à notre présence physique sur le site, nos rencontres avec l’équipe d’ingénierie et notre visite du site avec elle.
L’ICM : Parmi les technologies émergentes, lesquelles, le cas échéant, ont une grande incidence sur l’avenir de l’atténuation des risques de feux de forêt ?
M. Low : Nous utilisons la modélisation du comportement et du développement de l’incendie à un haut niveau, ce qui nous permet de modéliser des milliers d’itérations de scénarios d’incendies.
Nous avons eu un autre exemple, en C.-B., où une mine était reliée à une autoroute de 60 kilomètres sur un terrain montagneux. Compte tenu de son emplacement au milieu de glaciers, de pics rocheux et de couloirs d’avalanche, la mine était bien protégée des menaces des feux de forêt. Toutefois, le plus gros facteur de risque d’incendie était la route [utilisée] pour rentrer et sortir [du site] par le personnel, pour l’acheminement de l’approvisionnement et pour l’entière chaîne d’approvisionnement.
Nous nous sommes concentrés sur cette route, et avons modélisé le comportement du feu sur la base de nos évaluations sur place du type de combustible. Ces évaluations sont particulièrement importantes dans des zones où l’appariement des types de combustibles n’est pas idéal [là où la végétation locale n’est pas bien représentée par les catégories de types de combustibles dans la méthode canadienne de prévision du comportement des incendies de forêt (PCI)]. Nous avons ensuite effectué des modélisations afin de déterminer les incidences potentielles des feux de forêt sur la route.
De là, nous avons travaillé à rebours pour aider le client à comprendre. Si un feu commence dans certaines conditions et dans une proximité spécifique à la route, de combien de temps les personnes présentes sur le site disposeraient-elles avant de ne plus pouvoir accéder à la route, ou à quel moment l’incendie aurait-il un impact concret sur le site ?
Il est important de pouvoir donner un cadre au client. De fait, s’il comprend mieux une situation, ce dernier pourra adapter ou éclaircir son plan d’intervention en cas d’urgence.
Notre technologie permet également d’intégrer des données de détection et télémétrie par ondes lumineuses (LiDAR) dans un programme que nous appelons Fuel ID. Le combustible, la météo et la topographie sont les trois principaux éléments essentiels à l’analyse du comportement du feu. Il existe une [carte] du type de combustible pour tout le pays, et chacune des provinces a effectué sa propre cartographie des types de combustibles.
Forsite a conçu Fuel ID comme un processus qui utilise des données LiDAR et en retire les caractéristiques des arbres et de la végétation. Cela nous permet de classifier les combustibles et de développer des couches cartographiques des combustibles à une résolution bien supérieure à celles des cartes publiques des types de combustibles du gouvernement au Canada. C’est très important, car une couche cartographique des combustibles de meilleure qualité reflète mieux ce qui se trouve réellement sur le terrain, et on obtiendra de meilleurs résultats du modèle. Fuel ID est disponible pour certaines régions de l’Alberta, de Colombie-Britannique et de Saskatchewan. Nous sommes en train d’étendre sa couverture à l’ensemble du Canada.
Les autres solutions technologiques que nous offrons sont des solutions de modélisation personnalisées que nous avons développées pour nos clients des services publics pour les aider dans leur exploitation quotidienne du réseau. Dans certains cas, ces solutions peuvent facilement être adaptées au contexte minier. À leur base se trouvent des points, des polygones et des lignes sur le paysage, qui permettent aux clients de mieux comprendre les incidences pour eux d’un feu de forêt.