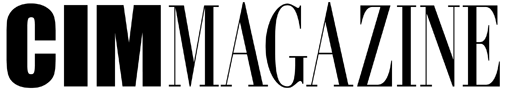Une idée erronée courante circule sur le lithium. Selon elle, parce que cet élément est abondant et essentiel, le lithium suffira à répondre à la demande dans un monde en pleine électrification. La réalité est toutefois plus complexe et, pour dire vrai, plus précaire. Si le lithium est le métal le plus léger du tableau périodique, il porte à lui seul le poids de la totalité de la transition énergétique. Il est donc temps de le considérer de la sorte.
Peu importe l’optimisme qui entoure l’innovation en matière de batteries et l’électrification, la chaîne d’approvisionnement du lithium reste largement inégale, exigeante du point de vue technologique et un véritable poids pour l’environnement. S’il ne s’agit pas d’une crise en soi, il ne faut pas non plus prétendre que ce n’est pas un problème. Commençons par le commencement : le lithium n’existe pas sous sa forme finale. Qu’il soit extrait de saumures riches en sel au Chili ou de pegmatites en Australie et au Canada, il faut une chimie complexe, ainsi qu’une quantité intensive de chaleur et d’eau ou d’énergie, ou des deux, pour obtenir du lithium utilisable sous une forme qui convient à la fabrication de batteries. Quand bien même, son affinage pour qu’il réponde aux spécifications de la clientèle vient ajouter une couche en termes de coût et d’émissions. L’idée selon laquelle la production peut augmenter sans cesse et sans conséquences est un mythe, qu’il faut déconstruire de toute urgence.
Faux pas stratégiques
Parallèlement, l’aspect géopolitique de la production de lithium reçoit moins d’attention qu’il ne le devrait. Plus de 60 % de l’affinage du lithium a lieu en Chine, ce qui confère un rôle disproportionné à la chaîne d’approvisionnement mondiale des batteries. Les nations occidentales essaient de rattraper leur retard, mais la courbe d’apprentissage est ardue, et de nombreuses occasions sont manquées.
L’histoire de la technologie d’accumulateurs lithium-fer-phosphate (LFP) est particulièrement marquante. Les permis pour la technologie LFP, à l’origine développée et brevetée au Canada, ont été délivrés aux entreprises chinoises sans redevances, à partir du moment où la production restait en Chine. Ce qui était le cas. Aujourd’hui, la Chine domine la production mondiale d’accumulateurs LFP, notamment les batteries usagées dans de nombreux modèles de Tesla. Ce n’est pas uniquement une décision commerciale. C’est un faux pas stratégique. Nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire cette erreur. Si nous voulons que le lithium soit au cœur des objectifs de décarbonation, nous devons investir non seulement dans l’extraction minière, mais aussi dans chaque étape de la chaîne de valeur, de l’extraction et du traitement au recyclage et à la composition chimique des batteries de prochaine génération. La course vers l’électrification est également une course pour contrôler l’innovation et l’infrastructure. À l’heure actuelle, nous sommes très en retard.
Solutions émergentes
Pour être clairs, des travaux importants sont en cours. Les technologies d’extraction directe du lithium (DLE, de l’anglais Direct lithium extraction) promettent de réduire l’utilisation d’eau et d’améliorer l’efficacité, mais elles doivent encore faire leurs preuves dans un contexte réel. Le recyclage des batteries gagne du terrain et offre une manière de récupérer des matériaux critiques à partir de batteries usagées plutôt que de s’en remettre à un approvisionnement vierge.
Les développements sont prometteurs, mais ne remplaceront pas la nécessité d’une stratégie cohérente et à long terme. La stratégie doit reconnaître la double vie du lithium. C’est une ressource minérale, mais aussi un outil géopolitique. Un enjeu technique et une question de durabilité. La réussite des projets ne dépendra pas uniquement des teneurs intéressantes ou de plateformes d’investisseurs tape-à-l’œil. Ces projets devront offrir des plans de traitement crédibles, promouvoir les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, mobiliser les parties prenantes et garantir la résilience de la chaîne d’approvisionnement à long terme.
Exploitation des déchets
La décision de mars 2025 de l’Union européenne de reclassifier le broyat noir en déchets dangereux pourrait paraître un détail bureaucratique, mais c’est en réalité un changement de stratégie. En restreignant les exportations vers les pays non-membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’UE signale qu’elle ne considère plus les déchets de batteries comme un produit jetable, mais comme un produit à exploiter. Le broyat noir, le résidu grumeleux des batteries usagées des véhicules électriques (VÉ), est riche en lithium, en cobalt et en nickel. Et jusqu’à présent, la plupart a quitté l’Europe pour être envoyé dans les centres de recyclage bien établis en Asie. Ceci constitue une autre occasion manquée.
Garder le broyat noir dans une région est une question qui va au-delà de la circularité. Il s’agit de contrôle. Le contrôle sur les matières premières, les émissions industrielles et les avantages économiques des chaînes d’approvisionnement en circuit fermé. Au même moment, cela s’aligne sur le durcissement des réglementations environnementales en minimisant le bilan carbone des flux de matériaux. Le changement de politique est un pas en avant, mais la transformation en une capacité réelle exigera des investissements, une infrastructure et une économie plus intelligente. Il n’est pas simplement question pour l’UE de s’agripper à ses déchets. Il faut qu’elle sache qu’en faire.
Spécifications stratégiques
Les transactions sur le lithium ne concernent plus uniquement l’approvisionnement, elles portent aussi sur la stratégie. Le lancement d’ExxonMobil dans le marché du lithium en 2023 par le biais de sa marque Mobil Lithium n’est pas une simple zone de ressources. C’est un signal pour les producteurs en amont qui pensent davantage comme des architectes de la chaîne d’approvisionnement. En faisant équipe avec des fabricants de batterie tels que SK On, le plus grand fabricant de batteries de Corée du Sud, ExxonMobil ne se contente pas de vendre du lithium. Elle construit conjointement un écosystème de VÉ national. Ce genre de partenariats stratégiques (entre les sociétés minières, les sociétés d’affinage et les fabricants d’équipement d’origine, ou FEO) devient le nouveau plan. Ces partenariats réduisent les risques, renforcent la visibilité et contribuent à aligner les calendriers de production sur les courbes de demande. Pour les FEO, il s’agit de sécuriser les intrants indispensables. Pour les producteurs, il s’agit de s’intégrer davantage dans la chaîne de valeur. Dans tous les cas, l’ancien modèle (consistant à creuser, à expédier et à espérer que quelqu’un achète) disparaît rapidement. À sa place naissent des alliances bâties pour la résilience et pas seulement pour les revenus.
Ainsi, la thèse est la suivante : le lithium n’est pas une simple matière première. C’est un écosystème. Et si nous continuons à l’envisager en simples termes de tonnes ou de prix du marché, nous allons en ressortir perdants, sur les plans économique, stratégique et environnemental. Il est encore temps d’adopter la bonne voie. Mais nous devons arrêter de courir après les raccourcis et commencer à construire des systèmes. Parce que si le lithium est le métal le plus léger, nos attentes n’ont jamais été aussi grandes.
Sasan Maleki est titulaire d’un doctorat en géologie économique. Fort de 15 années d’expérience dans l’exploration d’une vaste gamme de matières premières, notamment les minéraux critiques, il associe une expertise de terrain et des connaissances du marché pour soutenir la transition énergétique mondiale. Il est l’auteur de l’ouvrage Powering the Future: The Journey of Lithium from Earth to Battery and Market (Alimenter l’avenir : le parcours du lithium de la Terre aux batteries et au marché), disponible en anglais sur Amazon.
Traduit par Karen Rolland