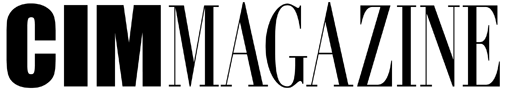Sur la couverture du Report into Workplace Culture at Rio Tinto (rapport dédié à la culture sur le lieu de travail à Rio Tinto) publié en début d’année, un avertissement relatif au contenu indique que, « en tant que lecteur ou lectrice, vous pouvez ressentir tout un éventail d’émotions, particulièrement si vous avez vous-même été directement affecté(e) ou avez été témoin des types de comportements préjudiciables [évoqués dans ce rapport] ».
En poursuivant ma lecture, je me suis remémoré l’époque où, armé de chaussures à embout d’acier et de tenues de travail à haute visibilité, je travaillais comme opérateur d’équipement lourd sur un chantier naval. La misogynie et l’homophobie désinvoltes de la main-d’œuvre, principalement composée d’hommes, animaient pratiquement toutes les conversations à l’heure du déjeuner. Quelques personnes sur le site pouvaient rendre votre journée misérable si telle était leur humeur. La direction ne faisait pas grand cas de ces attitudes. La seule chose qui lui importait était que l’on dégage le plus rapidement possible la file de camions arrivant sur place.
Je n’ai eu aucun regret à laisser cette culture derrière moi. D’autres lecteurs du rapport trouveront les détails présentés dans le rapport tout aussi familiers. Certains, comme l’on peut s’y attendre, auront des réactions bien plus fortes.
L’auteur avait toutefois de nobles intentions. L’objet du rapport était « d’identifier les difficultés rencontrées sur le lieu de travail telles que l’intimidation, le harcèlement sexuel, le racisme et d’autres formes de discrimination, et d’établir des recommandations qui pourraient renforcer la culture de Rio Tinto sur le lieu de travail et entretenir le changement culturel ». Ce rapport s’inscrit dans un effort plus vaste de la part de la société de rapprocher l’expérience vécue par sa main-d’œuvre gigantesque d’une culture plus diversifiée et plus inclusive, que sa direction (ainsi que les bureaux de direction de nombreuses sociétés de l’industrie minière) considère comme essentielle au succès futur.
Le résultat est un document exhaustif rédigé par une entreprise dirigée par Elizabeth Broderick, ancienne commissaire à la discrimination sexuelle pour le gouvernement australien. Le rapport s’appuie sur l’étude de plus de 10 000 employés du Québec et des Territoires du Nord-Ouest, 109 séances d’écoute menées dans plusieurs langues, des conversations personnelles, des soumissions écrites et des recherches. Il transcrit, sur la base de témoignages et de données, les expériences des travailleurs employés dans les exploitations de Rio Tinto.
Les résultats montrent que près de la moitié des personnes interrogées ont indiqué avoir été victimes d’intimidation, que le racisme et le sexisme sont monnaie courante dans toute l’organisation, que les contrevenants en série et leurs infractions sont souvent des « secrets de Polichinelle ». En outre, les employés n’étaient pas convaincus qu’en signalant ces problèmes par des voies officielles, ils obtiendraient une réponse adéquate.
Les résultats ne sont pas flatteurs, mais on peut féliciter la direction de la société d’avoir posé des questions difficiles et partagé les réponses. Le travail déjà en cours pour changer la culture de la société commence sur ces fondements solides. En rendant le rapport public, Rio Tinto a créé une ressource précieuse pour le reste de l’industrie, laquelle présente une série d’actions qui permettront d’opérer des changements et d’améliorer la formation et la gouvernance dans toute la société.
La recommandation finale est qu’une agence indépendante élabore un rapport dans les deux années à venir concernant l’avancement de la mise en œuvre des mesures proposées. Je suis impatient de le lire, et d’assister à la création d’autres initiatives semblables à celle-ci. Les personnes travaillant dans l’industrie, tout comme l’industrie elle-même, ont beaucoup à y gagner.
Traduit par Karen Rolland