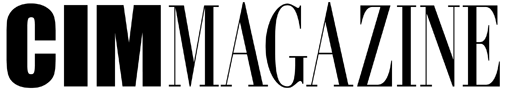Charlie Arngak, ancien maire de la communauté des Inuits de Kangiqsujuaq, a joué un rôle actif dans l’entente Raglan de 1995, dont l’esprit guide la relation entre Glencore et ses partenaires autochtones du Nunavik. Photo: Cedric Gallant
C'était l'une de nos histoires préférées de l'année. Pour voir la liste complète, consultez nos coups de cœur de la rédaction 2025.
Au début des années 1990, Charlie Arngak, à l’époque maire de Kangiqsujuaq, une communauté inuite du Nunavik, au Québec, a pris position pour son peuple en se rendant à Toronto pour rencontrer le directeur général de Falconbridge, une société minière canadienne qui souhaitait exploiter le nickel dans la région à cette époque. Une entente révolutionnaire est ressortie de cette initiative. Trente ans plus tard, elle demeure une référence en matière d’amélioration des relations entre les sociétés minières et les communautés autochtones.
« J’ai dû prendre position pour les membres de ma communauté et pour la population du Nunavik », déclarait M. Arngak dans un discours prononcé à la mine de Raglan en 2014 concernant sa rencontre avec le directeur général de Falconbridge Thomas Pugsley, qui ne s’attendait pas à la visite du maire. « Notre échange n’a pas été tendre, et il a compris que j’étais sérieux », ajoutait M. Arngak.
M. Arngak s’est engagé à ce que Falconbridge s’assoit à la table des négociations avec les membres de la communauté inuite concernant l’élaboration d’une entente avant que l’exploitation du nickel ne commence sur les terres qui leur sont si chères.
Cette initiative s’est traduite par des années de négociations parfois litigieuses, qui ont abouti à la signature de l’entente Raglan de 1995, la première entente sur les répercussions et les avantages (ERA) de ce type au Canada.
« La négociation n’a pas été facile », indiquait M. Arngak. « Parfois, nous devions sortir de la salle car les discussions étaient très frustrantes. Mais au final, nous revenions toujours et reprenions le débat. »
L’objectif était d’éviter de reproduire ce qu’il s’était passé avec Asbestos Hill, une mine à proximité de Kangiqsujuaq qui a soudainement été abandonnée dans les années 1980, laissant derrière elle des conséquences économiques, environnementales et et des impacts sanitaires à long terme pour la communauté.
Trente années plus tard, l’entente Raglan est parvenue à bien plus que ce qu’il était prévu qu’elle régisse. Elle est devenue un outil permettant aux Inuits du Nunavik de prendre le pouvoir sur les incidences environnementales et socio-économiques de la mine, et d’assurer leur expertise dans le secteur minier pour des générations à venir.
Réconciliation économique, du papier à la réalité
« Les choses ont été écrites noir sur blanc et blanc sur noir », indiquait le vice-président de la mine de Raglan Jean-François Verret dans un entretien avec l’équipe du CIM Magazine. « Nous devons comprendre, d’une génération à l’autre, la véritable signification de cette entente. »
Il l’a qualifié d’« esprit de l’entente Raglan », qui consiste à instaurer la confiance de manière proactive au travers de la réconciliation économique entre la mine et les communautés du Nunavik.
Sur le papier, l’ERA propose une participation aux bénéfices aux 14 communautés du Nunavik. Depuis sa création, Raglan a distribué 250 millions de dollars à la population inuite du Nunavik, les Nunavimmiuts, par le seul intermédiaire de la participation aux bénéfices.
L’entente rend aussi obligatoire qu’au moins 20 % du personnel de la mine soit inuit, avec une masse salariale annuelle moyenne de 18 millions de dollars spécifiquement allouée au personnel inuit.
La société a aussi investi 600 000 dollars dans des bourses d’étude pour les Nunavimmiuts souhaitant étudier dans un domaine spécialisé d’une faculté au Sud, ainsi qu’environ un million de dollars dans des projets d’intérêt local.
Pour aller plus loin, Raglan a créé le programme Tamatumani en 2008. Il regroupe plusieurs programmes se spécialisant dans la formation et le maintien en poste du personnel inuit.
L’un de ces programmes, le Stope School, permet aux élèves inuits n’ayant aucune expérience dans le domaine minier de se former à la mine. Une fois la formation effectuée et validée, les élèves sont accrédités par le gouvernement du Québec pour leur travail.
Une autre contribution de Raglan à la communauté concerne ses partenariats avec les entreprises inuites. M. Verret indiquait que 25 % des biens et services de la mine sont fournis par des entreprises détenues par des Inuits.
Grâce à ces partenariats, l’argent est indirectement utilisé pour des projets concrets d’infrastructure et socio-économiques au sein des communautés.
Nuvumiut Developments, détenue par la Salluit Qaqqalik Landholding Corporation et la Kangiqsujuaq Nunaturlik Landholding Corporation, a vu le jour en 1996, au lendemain de l’entente Raglan. La société explorait initialement des possibilités d’entreprise commune pour fournir les biens et services à Raglan, mais elle travaille également désormais avec Canadian Royalties (qui exploite une mine de nickel à proximité) tout en développant son activité pour inclure la gestion des ressources humaines, en se spécialisant dans le recrutement de personnel inuit au Nunavik.
« Nous essayons de prendre soin des besoins de notre population », déclarait Lukasi Pilurtuut, directeur général de Kangiqsujuaq à Nuvumiut Developments, dans un entretien avec l’équipe du CIM Magazine. Grâce aux bénéfices réalisés par Nuvumiut Developments, la société a pu réinvestir dans la communauté.
Les fruits de ces investissements sont visibles à l’Auberge Kangiqsujuaq, un hôtel de 14 chambres au cœur de la communauté. Un établissement pour personnes âgées a été construit pour rester dans la communauté, même en ayant besoin de soins spécifiques. Une maison familiale a été construite pour recueillir les femmes et les enfants fuyant la violence familiale.
« Nous nous efforçons d’utiliser l’argent que nous générons pour renforcer l’infrastructure dans notre communauté », expliquait M. Pilurtuut, ajoutant que Salluit, la communauté voisine, réinvestit aussi ses bénéfices de la même manière.
Raglan a aussi attribué de grands contrats aux entreprises inuites pour sa mine d’Anuri, un projet d’agrandissement majeur qui s’est terminé début 2024 et a ajouté environ 25 années à la durée de vie de la mine de Raglan.
Un contrat pour les travaux de terrassement à la mine d’Anuri a été attribué à un partenariat conjoint entre Kiewit et Nuvumiut Developments, un autre pour le développement souterrain a été accordé à un partenariat similaire entre The Redpath Group et Nuvumiut Developments, et l’entreprise commune entre Groupe Promec et JNA Nunavik Consulting a été chargée de construire l’infrastructure de surface.
« Nommez-moi un seul projet qui a été développé de cette manière et qui garantit de durer sur les 25 prochaines années. Je n’en connais aucun », indiquait M. Verret.
D’après lui, depuis l’agrandissement réussi d’Anuri, ce modèle de développement de projet en partenariat avec les communautés locales devrait être reproduit.
« Nous sommes là depuis 30 ans, et nous serons encore là dans 25 ans », ajoutait-il. « Cela représente toute une vie, c’est une vaste période, et c’est la raison pour laquelle nous devons investir dans les communautés, dans les relations, dans le respect. Cela paraît évident pour une relation commerciale qui pourrait durer 50, 60 ou 70 ans. »
Fermer la mine, pour la terre et les populations
La mine de Raglan devrait rester opérationnelle jusqu’à au moins 2040. En 2017, des intermédiaires dans la négociation de l’entente Raglan se sont de nouveau réunis pour ajouter des mesures supplémentaires à l’entente. L’une de ces mesures concernait la création d’un sous-comité dédié à la fermeture de la mine.
Arn Keeling, professeur à l’université Memorial de Terre-Neuve et membre expert impartial du sous-comité dédié à la fermeture de la mine, déclarait dans un entretien avec l’équipe du CIM Magazine que la création du sous-comité était à l’initiative des Inuits qui s’inquiétaient de la gestion future des résidus miniers. La plupart des membres et des chefs de la communauté n’étaient pas informés des plans de fermeture de la mine, ni n’y participaient.
Le dialogue entre Raglan et la communauté inuite se poursuit lors des réunions trimestrielles du sous-comité, et des questions toujours plus complexes y sont posées. « Dès que nous avons évoqué le plan de fermeture, nous avons commencé à trouver toutes ces questions auxquelles nous devions répondre », indiquait M. Keeling.
Sur le plan environnemental, des questions relatives au changement climatique ont été évoquées. Elles soulevaient notamment la question du changement de la gestion environnementale dans un monde où la température est amenée à augmenter de trois degrés. « Tout à coup, nous ne planifions plus sur la base du monde d’aujourd’hui, mais sur les prévisions futures de notre planète », ajoutait M. Keeling.
Les questions socio-économiques sont également devenues partie intégrante du débat. Lorsque le cycle de vie de la mine se terminera, qu’adviendra-t-il de l’économie qu’elle a créée au Nunavik, que deviendront les emplois créés, et comment les Inuits pourront-ils rebondir lors de la fermeture de la mine ? Ces quelques questions ont été évoquées durant les réunions du sous-comité.
« Nous n’avons pas encore les réponses, nous commençons à peine à renforcer notre engagement communautaire, à penser à l’avenir après la fermeture de la mine », indiquait-il. La durée de vie de Raglan étant prolongée jusqu’à 2040 au moins, d’après les prévisions, le sous-comité a le temps d’analyser ces questions et d’y trouver des solutions.
M.Pilurtuut expliquait qu’avec des entreprises telles que Nuvumiut Developments, les Inuits deviennent des experts et expertes dans le domaine de l’exploitation minière au Nunavik, une expertise qu’ils peuvent mettre à profit lorsque d’autres opportunités dans ce secteur se présentent dans la région.
« Beaucoup de sociétés minières mènent des activités dans la région. Selon moi, Nuvumiut Developments va se développer considérablement », indiquait M. Pilurtuut, qui espère que davantage d’Inuits continueront à devenir plus actifs dans ces projets.
Pour M. Keeling, le sous-comité dédié à la fermeture de la mine joue un rôle important dans le cycle de vie de la mine, car il débat de la prolongation de son cycle. « Les résultats seront meilleurs si l’on envisage la fermeture du site minier très tôt », indiquait-il, ajoutant que le bon moment pour penser à la fermeture de la mine est avant que l’exploitation ne commence.
L’un des premiers objectifs du sous-comité est de se placer à la pointe des meilleures pratiques au Québec, au Canada et à l’international. « Nous avons le sentiment que nous œuvrons dans cette direction », ajoutait M. Keeling.
Créer une relation durable
D’après M. Keeling, l’un des enseignements que le reste de l’industrie minière canadienne a tirés de la relation de la mine de Raglan avec les Inuits est l’obligation de consulter. Elle a officialisé la relation et l’a rendu plus forte que ce qu’elle n’était auparavant.
« Je ne peux pas dire que tout est parfait », reconnaissait M. Verret. « Mais cela fait partie de notre fondation, nous investissons de notre temps. »
À l’heure actuelle, Raglan est confrontée à une concurrence difficile dans l’industrie du nickel. De fait, les mines indonésiennes soutenues par la Chine absorbent rapidement le marché.
M. Verret reste dévoué à la philosophie de Raglan. « Peu importe ce qu’il se passe sur le marché, nous ne dévierons jamais du fondement de notre stratégie, à savoir le respect, l’esprit de l’entente Raglan », concluait-il.