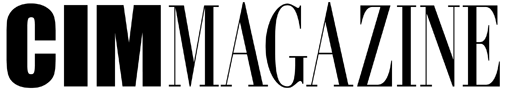Le Canada nourrit de grandes ambitions dans les domaines des ressources naturelles et de l’industrie, mais notre capacité à les concrétiser est compromise par un facteur moins visible : une approche défaillante en matière d’approbation des projets.
Qu’il s’agisse de l’extraction de minéraux critiques, du captage du carbone ou des infrastructures d’énergie propre, la demande en matière de réalisation de projets n’a jamais été aussi forte. Mais du point de vue de la gestion, le véritable risque ne réside pas dans le fardeau réglementaire, mais dans les systèmes obsolètes sur lesquels nous nous appuyons pour coordonner les décisions, recueillir les rétroactions et faire avancer les projets.
Le Canada affiche certains des délais d’approbation de projets les plus longs du G7. Selon la Banque mondiale, nos processus prennent souvent près de deux fois plus de temps qu’aux États-Unis ou en Australie. Pour les dirigeants qui gèrent d’importants projets d’investissement ou qui supervisent des portefeuilles d’actifs de développement, ces retards nuisent à la valeur, à la confiance des investisseurs et à celle des parties prenantes.
Le problème fondamental ? Nos processus d’examen réglementaire reposent encore sur des flux de travail fragmentés : fichiers PDF statiques, feuilles de calcul isolées, formulaires redondants et chaînes de courriels qui s’étendent sur des mois. Les promoteurs doivent soumettre à plusieurs reprises les mêmes informations à des organismes cloisonnés qui sont rarement alignés. Il n’existe pas de plateforme unifiée pour la collaboration, pas de visibilité en temps réel sur les calendriers ou les mises à jour techniques, ni d’espace commun permettant aux régulateurs, aux communautés et aux nations autochtones de s’engager de manière significative tout au long du processus.
Il ne s’agit pas là d’inefficacités mineures. Elles entraînent des freins opérationnels à tous les niveaux, ralentissent les prises de décision, gonflent les coûts et affaiblissent les relations avec les parties prenantes dont le soutien est essentiel.
Cela ne signifie pas pour autant que la réglementation soit le problème. Les normes rigoureuses du Canada en matière d’évaluation environnementale et communautaire constituent un atout. Mais en tant que gestionnaires et décideurs, nous devons reconnaître qu’un bon suivi repose sur des systèmes modernes. Sans les bons outils, même les meilleures intentions politiques se perdent dans l’inertie administrative.
Partout dans le monde, nos pairs s’adaptent. Les États-Unis intègrent des outils numériques dans leurs réformes fédérales en matière d’octroi de permis. L’Australie et le Royaume-Uni utilisent des plateformes en temps réel pour accélérer les examens tout en améliorant la transparence. Ces administrations ont compris ce que le Canada doit désormais adopter : l’avenir de la réalisation des projets dépend de la modernisation de la gouvernance des projets.
L’ironie, c’est que le Canada dispose déjà de la technologie nécessaire pour remédier à cette situation. Des innovateurs canadiens ont mis au point des plateformes sécurisées et collaboratives qui centralisent les données des projets, rationalisent les processus réglementaires et offrent un accès basé sur les rôles afin de garantir une participation inclusive, opportune et responsable.
Ces outils sont déjà utilisés pour transformer les délais d’obtention des permis, comme le montre le projet de sel Great Atlantic d’Atlas Salt, dont l’enregistrement de l’évaluation environnementale auprès de la province de Terre-Neuve-et-Labrador a été approuvé avec conditions en seulement 52 jours. Une version numérique de l’enregistrement est désormais utilisée pour faciliter le processus d’octroi des permis. Ainsi, tous les participants, des experts techniques aux représentants de la communauté, peuvent consulter les mêmes informations à jour, comprendre les délais actualisés et apporter une contribution significative à chaque étape. Imaginez que vous puissiez compresser des mois d’échange en quelques jours, sans sacrifier la qualité ni le principe de responsabilité.
En modernisant nos systèmes, nous pouvons non seulement aller plus vite, mais aussi nous améliorer. Des processus transparents et efficaces réduisent l’incertitude pour les investisseurs et offrent des voies plus claires pour la participation des Autochtones et les avantages qui en découlent. Ils renforcent la confiance du public dans l’intégrité et l’efficacité des décisions prises.
Du point de vue de la gestion, l’appel à « réduire les formalités administratives » passe souvent à côté de l’essentiel. Ce qu’il faut vraiment, c’est un changement de système. Nous avons besoin de flux de travail plus intelligents, d’environnements de données intégrés et de meilleurs outils pour favoriser l’engagement. Nous avons besoin de processus d’autorisation qui soient vérifiables, collaboratifs et efficaces dès leur conception. Ce changement ne se traduira pas seulement par un raccourcissement des délais, mais aussi par une réduction des risques, une amélioration des résultats et un rétablissement de la confiance dans nos méthodes de construction.
Ce qu’il faut maintenant, c’est une adoption plus large et un leadership tant dans l’industrie que dans le gouvernement afin de promouvoir cela. L’hésitation à adopter les nouvelles technologies s’explique par des raisons telles que l’inertie opérationnelle ou la résistance à changer les modèles de revenus bien connus.
À ce jour, de nombreux prestataires de services professionnels canadiens ont cherché à réduire leurs coûts en externalisant l’utilisation de technologies familières pour soutenir le développement de projets. On peut citer, par exemple, les SIG sur ordinateur de bureau externalisés à des prestataires moins coûteux en Inde et dans d’autres pays. Cette approche ne va certainement pas améliorer notre capacité à aller plus vite et ne permet pas de mettre en place des solutions canadiennes de valeur qui s’attaquent aux causes des retards grâce à une utilisation innovante de la technologie. De telles solutions pourraient être proposées comme des produits générateurs de richesse à d’autres marchés confrontés à des problèmes similaires, ce qui renforcerait encore la compétitivité internationale du Canada.
Les gouvernements doivent encourager la volonté d’accepter de nouvelles solutions dans le cadre du processus réglementaire, et l’industrie, y compris les promoteurs de projets et les prestataires de services, doit accroître sa productivité en s’ouvrant à l’utilisation de nouveaux produits canadiens innovants.
Les enjeux sont clairs : le Canada affirme vouloir être un chef de file dans les domaines des minéraux critiques, de l’hydrogène, de la fabrication de pointe et des infrastructures propres. Mais aucune somme d’argent ni aucune ambition ne suffiront si nous ne remettons pas de l’ordre dans les fondements du processus d’approbation des projets.
L’occasion est là, devant nous. Il ne nous reste plus qu’à décider de la saisir au mieux.
Corey Tucker est président d’ICI Innovations, une entreprise canadienne qui soutient le développement de projets régionaux et nationaux dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et des technologies propres.
Traduit par Julien Richard