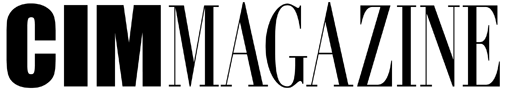L’installation de sources d’énergie solaire à l’échelle mondiale est en plein essor, motivée par ses coûts extrêmement compétitifs ainsi que par la transition vers des sources d’énergie à faibles émissions de carbone. Si l’on accorde une grande attention aux installations sur les toitures et dans les services d’utilité publique, le coût élevé des transports de carburant vers des lieux isolés constitue l’une des motivations principales pour intégrer les sources d’énergie renouvelables à la production de diesel afin de créer un système hybride de production d’électricité.
L’installation de panneaux solaires en Arctique pose de grandes difficultés, notamment en raison des températures extrêmement basses, d’un ensoleillement restreint pendant les mois d’hiver et des chutes de neige conséquentes. Cependant, l’alimentation en énergie solaire peut devenir une solution rentable pour les communautés isolées et les mines reculées de ces régions. Si le soleil de l’Arctique n’est présent que sur une courte période durant les mois d’hiver, l’été offre parfois jusqu’à 24 heures d’ensoleillement par jour pendant plusieurs semaines consécutives. Le printemps et les premiers mois d’automne sont également relativement ensoleillés.
Le village de Colville Lake, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), et le bâtiment abritant le centre de recherche du Nunavik (CRN) à Kuujjuaq, au Québec, constituent deux exemples parfaits de lieux isolés ayant mis à profit cette solution rentable. Tous deux ont installé des panneaux solaires produisant respectivement 136 kWAC et 50 kWAC d’énergie solaire.
Des installations à grande échelle sont en cours d’étude, et les premiers résultats montrent un coût potentiel nivelé de l’énergie (comprenant les frais d’installation, de transport et de mise en service) de 20 cents/kWh sur une durée de vie de 20 ans. Ceci constitue une économie importante par rapport à la production de diesel, dont le coût peut varier de 23 cents/kWh pour les grands sites miniers à 65 cents/kWh pour les communautés isolées.
Le modulaire est roi
La nature modulaire des panneaux solaires et de leur équipement connexe donne la possibilité d’un développement par étapes moins risqué et de coûts inférieurs pour les projets. On peut livrer tout le matériel requis pour le projet sur le site isolé dans des conteneurs d’expédition standard par l’intermédiaire de réseaux routiers existants. Ainsi, si l’on envisage une version à plus grande échelle de ce projet d’installation de panneaux solaires, il suffira d’envoyer des conteneurs supplémentaires sur le site.
Par rapport à l’énergie éolienne, outre l’expédition et l’assemblage plus simples de l’équipement, il est beaucoup plus aisé d’obtenir un permis pour l’énergie solaire et son acceptation sociale est meilleure. L’évaluation de la ressource solaire est également plus directe, car il n’est pas nécessaire de mener des campagnes de suivi longue et coûteuse pour déterminer sa faisabilité.
Des « suiveurs solaires » pour optimiser la production d’énergie
Contrairement aux régions proches de l’Équateur où il passe directement au zénith, le soleil suit l’horizon dans les hautes latitudes de l’Arctique, traçant un cercle plutôt qu’un arc de cercle. En raison de cette trajectoire, il est plus difficile pour les systèmes fixes de panneaux solaires de capter la production solaire abondante durant les mois d’été.
Les capteurs d’énergie solaire (aussi appelés « suiveurs solaires ») à un ou deux axes orientent les panneaux vers le soleil et optimisent la quantité d’énergie solaire produite à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. Le captage à un axe permet d’ajuster les panneaux afin qu’ils suivent latéralement le soleil sur l’horizon ou qu’ils s’adaptent aux changements d’élévation du soleil au fil des saisons ; le captage à deux axes, quant à lui, permet de gérer ces deux variations. À l’aide de ces systèmes, le facteur de charge de l’énergie solaire (la production moyenne d’électricité exprimée en pourcentage de la puissance installée totale) peut atteindre 19 % avec le captage à un axe et 21 % avec le captage à deux axes, par rapport à 14 % avec des panneaux solaires à axe fixe.
À DÉCOUVRIR: La composition complexe des métaux nécessaires à la fabrication des batteries, les forces du marché et les progrès de la science
De fait, l’installation et la mise à l’essai fructueuses effectuées par Cambridge Energy Partners et Solvest à Whitehorse, dans le Yukon, ont montré que l’efficacité des panneaux solaires augmentait à des températures plus basses.
Deux faces valent mieux qu’une
Les modules biface, récemment lancés dans le commerce, permettent de capter le rayonnement solaire sur les deux faces du panneau, ce qui présente un intérêt particulier en Arctique car les rayons du soleil peuvent être déviés par le sol et la neige. Par rapport au panneau solaire monoface, la production d’énergie solaire en biface permet d’augmenter le facteur de charge de jusqu’à 3 % (soit une hausse de 23 % en termes d’énergie). En outre, l’absorption du rayonnement solaire sur la face arrière du panneau produit de la chaleur, ce qui fait fondre la neige sur la face avant plus rapidement que sur un panneau monoface, augmentant encore davantage la production d’énergie solaire.
La performance des panneaux solaires s’améliore au fil du temps, et le facteur de charge déjà raisonnable augmentera de la même façon. Parallèlement, le prix du matériel devrait continuer à baisser. Ainsi, avec le temps, l’adoption de l’énergie solaire se justifiera de plus en plus.
Un avenir brillant pour l’énergie solaire en Arctique
L’adoption de cette source d’énergie dans des lieux isolés ne cessera de croître, car l’énergie solaire est reconnue comme une solution pragmatique et à faible impact qui nous permettra de nous affranchir de notre dépendance aux carburants fossiles et de diminuer les coûts liés à l’énergie dans les régions isolées. La réussite probante de ce projet, associée à une profonde maturité technologique, assure à l’énergie solaire une place de choix dans l’Arctique.
Michel Carreau est directeur international de l’énergie hybride et des microréseaux chez Hatch.